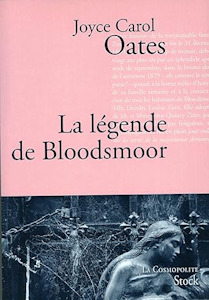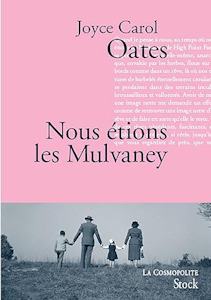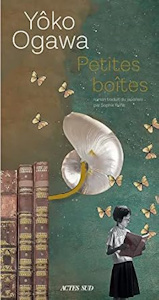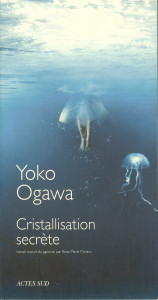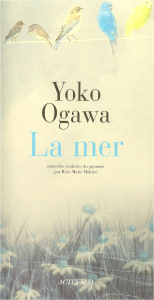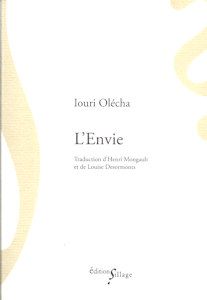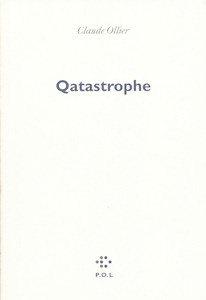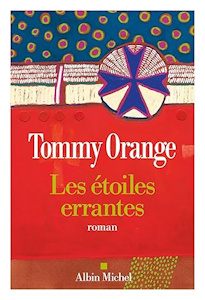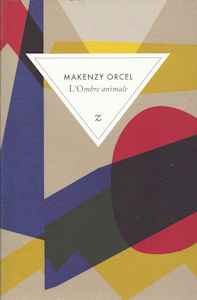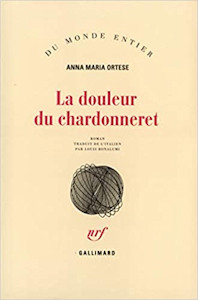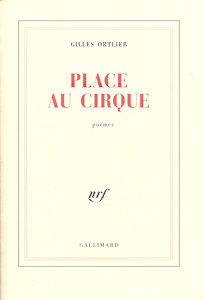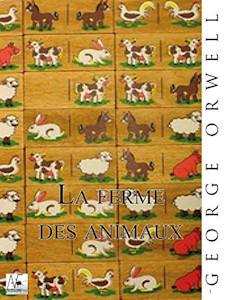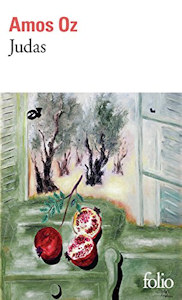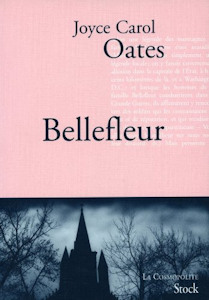
JOYCE CAROL OATES
Bellefleur
" C’était il y a des années, lors de la période obscure, chaotique, insondable, qui précéda (de près de douze mois) la naissance de Germaine, un soir de la fin septembre troublé par la frénésie de vents innombrables, tels des esprits se livrant combat – tantôt plaintifs, tantôt en colère, tantôt subtils comme l’écho délicat du violoncelle, pénétrant au point de vous glacer la nuque et les épaules –, un soir si tourmenté, comme imprégné d’une odeur de soufre, un soir si lourd d’une nostalgie inarticulée que Leah et Gideon Bellefleur se querellèrent une fois de plus dans leur immense lit, la gorge nouée de sanglots parce que leur amour était trop dévorant pour accepter les limites de leurs corps de simples mortels ."
"Le manoir fut construit tout en haut d’une vaste colline verdoyante environnée de pins argentés, d’épicéas et d’érables de montagne, donnant sur le lac Noir et, au loin, sur le mont Chattaroy enveloppé de brumes, le plus élevé des sommets des Chautauquas. La splendeur du manoir, ses tours et ses murs crénelés en faisaient un château gothique anglais dans son architecture globale, avec une certaine influence mauresque (car tandis que Raphael étudiait les plans d’innombrables châteaux européens et congédiait un architecte après l’autre, l’esprit de la construction se modifiait naturellement), d’une beauté sauvage, tentaculaire, jamais vue dans cette partie du monde."
JOYCE CAROL OATES
La légende de Bloodsmoor